Coquelicots et barbelés – juin 2013 (©Claude Fèvre)
25 mai 2020, retour sur cinquante cinq jours de confinement
Une cage où l’on apprend l’oiseau
Avec
René Frégni auteur de Carnets de prison ou l’oubli des rivières (éditions Gallimard, collection Tract, 2019) – Fleury l’été, texte et spectacle de Lucienne Deschamps avec Serge de Laubier (éditions Temps des Cerises Jean Desfonds, auteur de Corbacabana, écrivain public en prison (Editions du Panthéon, 2018) – Valérie Müller, réalisatrice du documentaire Danser sa peine, avec le chorégraphe Angelin Preljocaj
« Une cage où l’on apprend l’oiseau » les mots sont de Claude Nougaro, dans sa chanson La danse… « À la barre de chêne se pliaient les roseaux /De nos corps amoureux de cadences »…
Pendant les cinquante cinq jours que dura cette étrange interdiction de toute forme d’échanges, de rencontres où le corps serait présent, cette privation de la plus élémentaire liberté de déplacement, ce fut bel et bien être en cage. Du moins pour certains d’entre nous, seuls dans leur appartement. Ce fut, toutes proportions gardées bien sûr, une forme d’emprisonnement. Il nous fallait, sans préparation aucune, apprendre à être oiseau en cage… Oui, apprendre à rester vivant, sensible, attentif aux beautés des jours, observer les plus petits signes d’un printemps naissant, s’en réjouir, en acceptant ses barreaux.
Dès le jour 4, Wajdi Mouawad qui nous accompagnera avec son quart d’heure de journal sur le site du Théâtre de la Colline dont il est le directeur, évoque cette sensation de buter contre un obstacle empêchant de poursuivre son envol… Il se compare alors à une mouche qui s’obstine contre une vitre… Il faut à tout prix trouver le moyen de ne pas s’obstiner comme elle… Alors, bien sûr, pour ne pas s’obstiner il a écrit, ce que nous avons fait aussi quand d’autres chantaient, jouaient de leur instrument, peignaient… La mouche ainsi s’est évadée, l’oiseau s’est mis à voler en dépit des barreaux de sa cage.
C’est alors que certains livres – à commencer par La Peste d’Albert Camus, si souvent cité – certains enregistrements de spectacles, certains documentaires ont pu prendre tout leur sens, surtout quand ils abordaient l’univers de la prison.
Ainsi au jour 10 du confinement, le 26 mars sur France 3, nous avons découvert le documentaire Danser sa peine, Grand Prix Documentaire National au FIPADOC 2020. Nous avons partagé l’expérience de cinq femmes, Malika, Annie, Sylvia, Sophia et Litale, incarcérées à la prison des Baumettes à Marseille. La réalisatrice Valérie Müller y suit le travail du danseur et chorégraphe Angelin Preljocaj auprès d’elles, un atelier qui les mènera sur scène à Aix –en –Provence, à Montpellier. Nous assistons au lent et patient apprivoisement de leur corps, de leur confiance mutuelle. Nous découvrons leur réalité au sein de la prison, les effets de la détention et ceux de la soudaine irruption de la création, de la danse.
Coïncidence ? De Marseille, des Baumettes, et d’autres prisons encore, il est beaucoup question dans la quarantaine de pages de l’écrivain René Frégni publiées en décembre 2019 dans la collection Tracts chez Gallimard, Carnets de prison ou l’oubli des rivières. Il faut se précipiter sur ce petit opuscule d’à peine 4€ pour comprendre le parcours inouï de cet écrivain, animateur d’ateliers d’écriture au sein des prisons, habité d’une foi de charbonnier dans la lecture et l’écriture. Il faut l’écouter raconter l’amour d’une mère –« Quand on a une mère et trois livres on ne devient pas monstrueux » ‑son errance, le cheminement inattendu pour trouver sa voie. C’est en prison, auprès d’un objecteur de conscience, professeur de philosophie qu’il découvre à la fois « le monde magique de la culture » et le goût d’écrire, dans les sept mètres carrés de sa cellule. Il n’aura de cesse bien plus tard de faire partager à d’autres son expérience : « Ceux qui s’arment un jour d’un stylo sont sauvés… Par les passages secrets que dessine l’encre, ils retrouvent les voies menant aux rêves, à la mémoire, au monde. » Ces pages témoignent de la magie de l’écriture quand elles évoquent Yves qui s’inventa une histoire d’amour épistolaire avec Mathilde. Il était l’auteur des lettres des deux correspondants et partageait ses lettres avec tout l’atelier qui se mit à rêver avec lui. Mais ces pages sont aussi un avertissement, une peur devant notre planète malade, et surtout devant nos ghettos, « ces grandes métropoles où s’accumulent les hommes perdus ».
Lisez, lisons encore et encore ce texte majeur.
Cette lecture pourrait aussi s’enrichir de celle des cinquante sept portraits de détenus rassemblés par Jean Desfonds, écrivain public en prison, Corbacabana, paru aux Editions du Panthéon en 2018. On aimerait que ces lettres qu’il rédige avec eux, pour eux dans cette prison de Perrache et de Corbas, que ces échanges emprunts d’humanité les arrachent à leurs barreaux, ceux de la pauvreté de langage, voire de l’illettrisme ou de l’incapacité à maîtriser notre langue. C’est toute une humanité échouée là, à tous âges, sans distinction de sexe, qui exhibe ses cicatrices…
Enfin, pour donner de la chair à ces lectures, on peut assister à la captation du spectacle de Lucienne Deschamps avec Serge de Laubier le 12 mars – la veille de l’interdiction imposé à toute forme de spectacle vivant ! – à la Parole errante – Armand Gatti. Lucienne Deschamps signe là un long poème Fleury l’été (paru le 10 mars au Temps des cerises) qu’elle lit, interprète, chante, crie avec une force, une énergie bouleversante. Nous sommes littéralement happés par ce qui se déroule en scène. Un peu moins d’une heure pour entrer avec elle dans la cage. Le mot est prononcé.
Le musicien qui l’accompagne et chante aussi porte ses « machines » au bout des bras, ce qui lui donne une étrange allure de robot froid et mécanique. A lui seul, il serait ce monde concentrationnaire que la lectrice vient habiter pour y animer des stages de chant. Ce monde qu’elle nomme assez vite « Volière où je serai oiseau » – ces mots résonnent si bien avec ceux de Claude Nougaro. Avec elle nous parcourons des « couloirs à n’en plus finir », nous franchissons des portes blindées et encore des portes, même virtuelles, des grilles, des tourniquets… Un monde barreaudé. « Dans un coin le piano noir offert par Barbara »… Et soudain, comme une apparition « un rosier, très rose /un chat à demi sauvage au soleil sur les poubelles… Ils ne savent pas qu’ils sont prisonniers… » Des bribes de conversation, des appels, des cris, des murmures, des souffles, des rires et du rap, son rythme « comme une machine à laver qui me répète un prénom »… Beaucoup de questions… « ça sert à quoi un yoyo ?… ça serait quoi un temps vivant ?… Pourquoi t’es ici ? » La voix de la lectrice, les sons du musicien donnent vie à « tous ceux qui ne faisaient que passer », à cet univers caché, honni, interdit où l’atelier chant accorde un temps de ciel moins gris, efface pour un temps, un temps seulement, les barreaux.
En ce début de retour à la vie, en ce 25 mai, nous savons que nous avons vécu en cage, qu’il ne servait à rien de nous obstiner contre ce qui nous empêchait de voler… Comme l’écrit si bien René Frégni, ce sont les mots dits, lus, chantés, écrits qui nous ont ouvert des fenêtres.




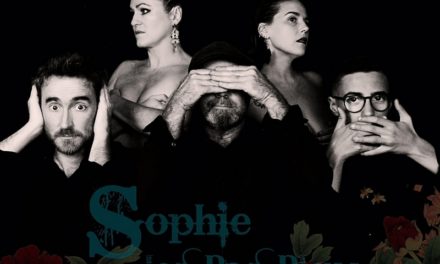


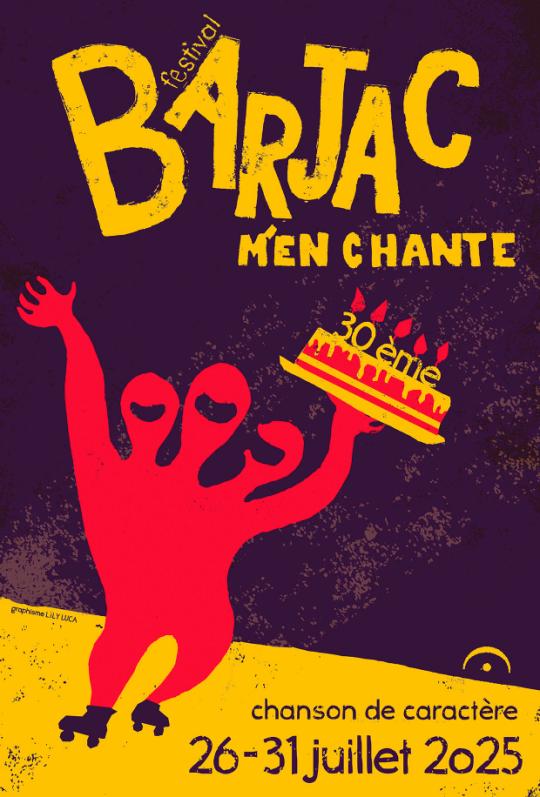
Merci Claude de cette fenêtre ouverte pour penser, panser un peu plus profondément cette période qui nous a bien touchés dedans. je vais aller découvrir tes propositions. çà m’a rappelé le temps où, apprenti chanteur en scène, je tentais d’interpréter Betty, de Lavilliers, et c’était bouleversant de rentrer dans ces mots.
Finalement, cher Olivier, suis très heureuse d’avoir ainsi cheminé, en écrivant régulièrement sur ce qui me touchait, sur ce que j’avais envie de partager… Merci pour ce commentaire qui me touche beaucoup.