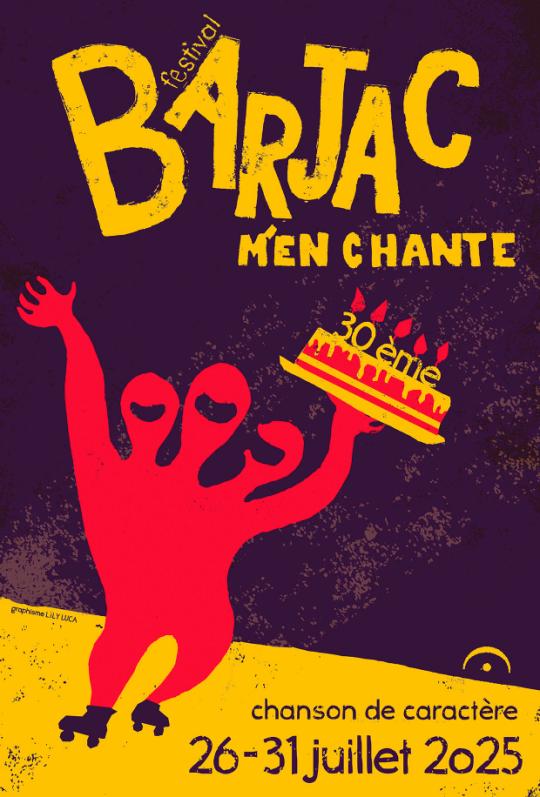Cyril Adda – L’îlot, 2020 (© Marylène Eytier /Au Bon Déclic)
11 avril 2021 – De clip en clip
« Tout reprendre à zéro, ce maudit rafiot… »
Avec
Cyril Adda, L’îlot, album éponyme sorti en février 2020, réalisation Florie et Cyril Adda, scénographie Florie Adda
Herenger, La banquise, album Dreamer faux rêveur sorti en février 2021, réalisation Kevin Bodin Films
Bertrand Betsch Ainsi soit-il, album Demande à la poussière, réalisation B/B
Didier Sustrac, Langue de bois, album Marcher derrière, en duo avec Princesse Erika réalisation Sylvain Pierrel, tourné au théâtre de l’Adagio à Thionville
On la connaît bien cette métaphore du voyage, de la navigation… Et cette question plus que jamais d’actualité à l’heure où un puissant virus a mis à l’arrêt des pans entiers de nos vies : changer d’avis ? Changer d’habit, de route ? Enfin tout remettre en question, quoi… Mettre un grand coup de pied dans nos habitudes. Allez, finissons- en avec les téléphones et les tablettes, « des flaques toxiques, /Des rapides tourbillons, /Le courant électrique », chercher au fond de soi la solution…
Et ce n’est pas sans dérision que Cyril Adda a voulu illustrer cette pensée, dans le titre éponyme de son nouvel album, l’îlot. Voici donc le clip, sur une scénographie pour le moins originale et la co-réalisation de Florie Adda, qui nous embarque dans un voyage, une fuite avec pour toute embarcation un canot pneumatique. C’est dire si la traversée sera agitée… Un semblant d’habitant des régions polaires ‑si l’on en croit l’équipement – chassé par le dérèglement climatique, affronte les eaux des fleuves et des canaux de notre vieille Europe…Et c’est ainsi qu’apparaissent sur l’écran de la scène où se joue cette tentative d’évasion des images de Londres, Bruges, Budapest, Lille ou Strasbourg…
Il n’est pas impossible aussi que ce clip, un an après sa sortie, puisse illustrer le projet même de cet album soumis aux aléas de cette pandémie. Pas impossible non plus qu’il traduise celui de réunir dans un même album les chansons d’un précédent EP et les six nouvelles chansons : des bouts de chemins de vie, dit Cyril Adda lui-même, des histoires vraies, qu’il évoque sans détour, comme le taulard accusé à tord, l’élève victime du harcèlement, ou la femme victime des violences conjugales… En quelque sorte une traversée artistique dans cette société, dans ses remous, ses tourbillons… Notons au passage que c’est une joie de le retrouver accompagné dans quelques titres par l’ensemble DécOUVRIR, par son quintet à cordes, la clarinette et le piano d’Etienne Champollion.
Les lendemains menacés, voilà bien aussi ce qui hante Herenger dans son album nourri de ses voyages, de ses rencontres, des sons familiers des guitares pop rock… Malgré les questions et les doutes, il ne saurait se départir de ses rêves. Tel le « gardien de phare » qui se demande s’il saura encore aimer de retour sur terre, il écoute « les muses volages … en silhouettes légères infinies », il écoute leurs murmures, « des hordes de mots »… et reste fidèle à ce gamin qu’il fut « A tant jouer les plumes en herbe… à tant rêver de la bohème »…Il n’a pas vraiment grandi, se laisse aller à deviner des silhouettes dans les nuages, paréidolie ordinaire et c’est tant mieux… Son dernier clip emprunte lui aussi à La Banquise, à ce qui fond, disparaît lentement et pleure des « larmes de géants »… « Faut-il dire adieu à Venise ? /Faut-il dire c’était ça la banquise ? » Les images en clair obscur alternent celles d’un feu de camp, d’un groupe qui échange autour et celle d’une piste de danse où l’alcool coule à flot, où dansent et boivent des visages masqués de dentelle, dans l’ivresse et l’oubli des menaces… « Sous l’ombrelle, piquée dans la cerise /Je l’ai vue /Je l’ai vue /La banquise. » Les derniers plans nous confrontent à l’homme debout dans une eau qui pourrait l’engloutir et surtout à ce piano abandonné sur une plage où déferlent les vagues imperturbables.
Insatiable Bertrand Betsch… Après son album La traversée dont la critique n’était pas encore vraiment remise, voici qu’il sort un dyptique électro-rock en version numérique, Demande à la poussière puis Orange bleue amère dont il signe absolument tout : paroles, musique, instruments, voix, sampleur, arrangements, mixage et réalisation des clips.
Cette prolixité, cette abondance trouve son explication dans le « chagrin du monde ». « Mes chansons oscillent souvent, dit-il, entre élans de tristesse intérieure et épiphanies procurées par la beauté du monde (ou du moins ce qu’il en reste). Pour conclure : « L’art est pour moi le moyen d’accéder à une forme de résilience ». Bien entendu, ce qu’il disait là au sujet du clip du titre Bus 51, extrait de Rater sa vie de presque rien, trouve encore son illustration dans le clip du titre Demande à la poussière, dans ses images funéraires, son texte « Fais bien toutes tes prières /Tu chanteras sous terre », son refrain en anglais « Ashes to ashes /Dust to dust /No more wishes /No more lust /More and more bruises » et cette vision apocalyptique : « Tout est fracassé /On aura rien laissé /On aura bien tenté… »
A cette dystopie, répond le clip de Ainsi soit-il. Le texte est une longue litanie de préceptes, d’invitations : « Laisse-toi chavirer /Laisse-toi emporter /Apprends à marcher /Apprends les sentiers /Apprends à voler /Apprends les nuées /Apprends la patience /Et comble l’absence » A peine l’homme blond aux yeux d’un bleu perçant apparaît-il, visage empreint de gravité, de tristesse que lui succèdent un feu, une pluie en averse. Vont se succéder des images d’hommes et de femmes dans leur quotidien, souvent hostile, des paysages aussi où dominent l’eau vive, le ciel, une route dans une atmosphère gelée… L’homme blond réapparaît en gros plan, on voit s’esquisser un très léger sourire… Car ce clip est avant tout un chant d’espérance « Apprends à mourir /Apprends à guérir /Apprends à finir /Pour mieux repartir /Apprends à vivre /Apprends à vivre… »
Pour refermer cette page de doutes, de menaces, on choisira une bossa nova, le clip Langue de bois, qui réunit Didier Sustrac et Princesse Erika. Bien entendu on ne manquera pas d’y voir le souci de revenir à la danse, à la sensualité que dégage Princesse Erika se déhanchant sur le chant et la guitare… Didier Sustrac est un familier des duos, certains ont même fait date. On l’a vu aux côtés de Chico Buarque, Claude Nougaro, Pierre Barouh… On a même vu cette chanson même interprétée avec toute une belle équipe au Bouche à Oreille à Bruxelles l’été dernier : Odile Barlier, Roberto Di Ferdinando, Eric Guilleton et Osman Martins.
On aime cette caméra qui tourne autour du duo dans un théâtre vide. On aime voir ces fauteuils et cette scène qui signent et dénoncent notre manque, notre privation de spectacles vivants. On aime les gros plans aussi sur les interprètes et leur complicité, leur tendresse… Et puis ce texte qui, sous l’innocente danse, dénonce les travers de discours dénués de substance : « Langue de bois, tu dis quoi /A chanter la messe tout bas /A faire feu de tout bois …Dis ce que tu voudras /Ton bla bla bla c’est du charabia /Moi ma langue de cœur /c’est tout mes patois ».