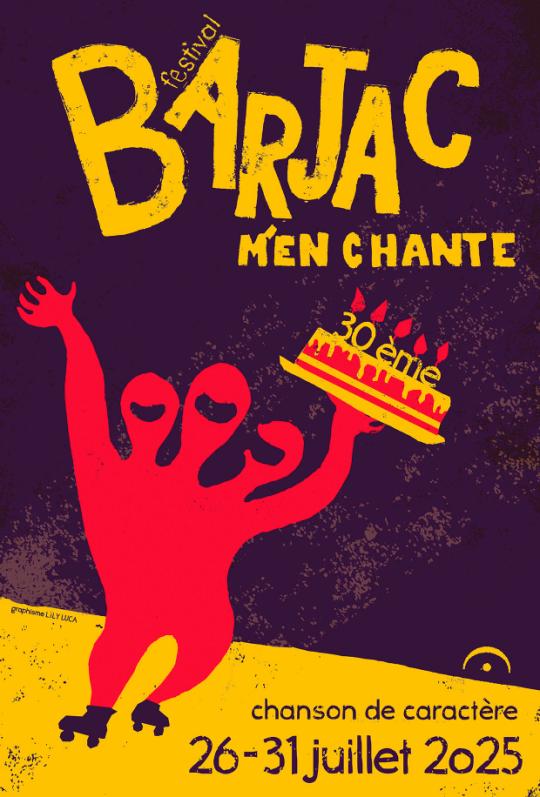Le Banquet invite Nicolas Jules – Le Bijou – mai 2022 (©Claude Fèvre)
4 au 5 mai 2022 – Le Banquet invite Nicolas Jules – nouveau projet d’Alice Bénar
Le Bijou et ses gourmandises sonores
Avec,
Clément Janinet (violon) Clément Petit (violoncelle) accompagnant Nicolas Jules (voix, texte)
Alice Bénar (textes, musiques, voix) Quentin Daniel (guitare, ukulélé, basse) Aina Tulier (nyckelharpa, bodhran)
Le Bijou (Toulouse)
Saura –t- on jamais le prix d’une programmation qui s’écarte des sentiers trop fréquentés, qui prend le risque de l’insolite, de la nouveauté, de la surprise ? Saura-t-on jamais la chance d’assister aux pas de côté que suscite la création chez certains artistes, ceux qui ne se satisfont jamais de leurs acquis quand bien même le spectateur les y encouragerait ?
Voilà que, dans une même semaine, la salle du Bijou nous pousse à la découverte… Et pourquoi ne pas oser dire à l’étrange ?
Filons la métaphore puisque le quatuor à cordes Le Banquet nous y invite. « Pluriel et sans frontière …Comme un écho à ce que fut la musique de table qui accompagnait fêtes et banquets » laissons nous conduire « à sa table pour une douce orgie acoustique »… Voilà qui doit mettre l’eau à la bouche des musiciens, particulièrement des musiciens de jazz. Mais ce n’est pas tout, puisqu’ici, ce soir, deux d’entre eux – violon et violoncelle- vont relever le défi d’accompagner à l’identique ou presque, leur projet avec Nicolas Jules, poète et chanteur. Nul n’ignore son verbe affranchi de toute règle, toute convention, déroutant, baroque, subversif souvent, non sans humour et autodérision … Un siècle plus tôt il aurait pu rejoindre les dadaïstes.
C’est un défi que d’essayer de rendre compte de cet objet non seulement sonore, mais aussi visuel, d’une heure environ. Car c’est un spectacle d’abord de voir ces deux musiciens et leur gestes précis sur le bois, les cordes de leurs instruments dont ils tirent des sonorités improbables, mécaniques, métalliques, lyriques aussi bien sûr… Impossible de savoir s’ils ont suivi le texte ou si c’est le texte qui les a suivis dans leurs improvisations…
C’est un spectacle aussi de découvrir Nicolas Jules, que nous connaissons trublion imprévisible face aux spectateurs, ici dans une tenue impeccable – très chic ce noir ! – une gestuelle maîtrisée, une écoute sans failles, corps et regard tendus le plus souvent vers ses accompagnateurs. Le texte est dit dans une diction parfaite, alliant douceur et violence… C’est un peu comme si nous assistions à l’émergence des mots dans sa gorge, parfois des cris, mais vite retenus, à leur irruption à la table d’un café où il serait venu tromper la douleur de la rupture. Car, disons-le, il s’agit bien de laisser venir les pensées, les émotions et les sensations d’un amour fini. « Tes yeux ont la petite lumière rouge de quand c’est occupé ». Il s’agit d’une errance qui commence dans la ville « La danse jaune des tramways, le petit jour sur le Canal… la ville en réseau et moi qui marche sur le réel avec des pieds d’oiseau… » Et ce constat « La tour de contrôle ne contrôle plus grand-chose » qui fait que l’errance se poursuit une heure durant jusqu’à ce que le cœur devienne cette chose sanguinolente posée sur une planche à découper en petits dés… Jusqu’à ce que la peur gagne, la peur d’être dans le viseur d’un révolver dans le dos… Et toujours, toujours marcher, « aller voir ailleurs si j’y suis… ». Tenter vainement d’échapper aux « mots tirés à bout portant, mots froids et durs, » se sentir « à l’amende quelque part dans la galaxie. » Seul dans « la ville d’impasses, la ville de barrières, la ville de chantiers, la ville de détours… »
Et voilà que le vendredi le Bijou invite Alice Bénar, en compagnie de deux musiciens qui, avec elle et pour elle – leurs regards ne la quittent pas ! – dessinent un tout autre monde, très loin, très loin des rumeurs de la ville… On vous invite à imaginer. A jardin c’est Aina Tulier avec sa harpe d’origine suédoise, la nyckelharpa (« vièle à clavier ») instrument dont le son nous transporte loin dans le temps, celui des cathédrales… mais aussi avec son bodhran, petit tambour irlandais qui viendra faire écho au tambour qu’Alice fixe à sa taille… A cour c’est Quentin Daniel qui l’accompagne de la guitare, de l’ukulélé ou de la basse… Alice, elle, presque gracile, sobrement vêtue de noir, une grappe de feuilles vertes fixée dans sa chevelure, a près d’elle un pupitre qui lui offre de multiplier sa voix, ce qu’elle fait, soulignons –le, avec une délicatesse infinie. Avec Alice, on entend même craquer les feuilles…
Nous la connaissons, Alice, nous connaissons ses instants ténus de création, dentelles de mots et de sons comme celui qu’elle nous offert à Noël dernier. Un haïku sonore déposé dans un lieu d’art contemporain où les œuvres de herman de vries empruntaient à la terre, la pierre, le bois et les végétaux du pays où il exposait. Si nous nous remémorons cette création c’est qu’elle fait écho parfaitement au spectacle qu’offre le trio ce soir.
Ecoutez, « ça commence comme ça, un désert »… Alice nous invite à pousser les murs, à agrandir le territoire, à se laisser conter des histoires par les oiseaux… Qui peut résister à une telle invitation ? Nous en témoignons : le trio viendra effectivement mettre un bout de lumière dans ce désert… Une pluie d’images et de sons… La vie en somme. Car on se laissera happer par la symbiose, la fusion des langages, celui des voix, celui des instruments, mais aussi celui des corps. Les mains d’Alice vous dessinent des arabesques, son visage est un paysage et parfois elle danse…
Très vite nous avons le sentiment d’assister à une célébration. On se promet d’y revenir pour y puiser encore cette grâce et cette beauté, pour oublier une heure durant les choses qui bloquent, dit Alice, « les grèves de train, les pandémies et les histoires d’amour impossible »… Alors oui, on reviendra…
On attendant, on gardera en mémoire quelques instants de beauté suspendus : la traversée au-delà de l’Océan pacifique pour quelques minutes au Japon où « les vagues s’esclaffent et le ciel se pâme », la promenade dans les bois où basse et tambours, hibou « du haut de son grand chêne » et inévitable coucou nous font escortent en terre d’enfance, la statue de terre et ses efforts pour s’arracher à son immobilité et « courir en robe légère », la chanson où la neige se dépose partout, partout, le bord de scène a capella qui nous emmène en hiver, au coin du feu, et surtout ce duo d’une délicatesse infinie, avec Quentin et son ukulélé où Alice parle de son grand-père qu’elle n’a jamais connu avec les yeux de sa grand-mère… Tant d’amour et de tendresse dans un rond de lumière. Pour finir c’est dans sa cabane qu’on se laisse inviter… une cabane comme on en bâtit en enfance et en rêve… Pas étonnant, les murs sont en papier de riz.