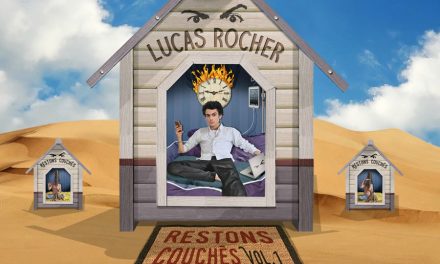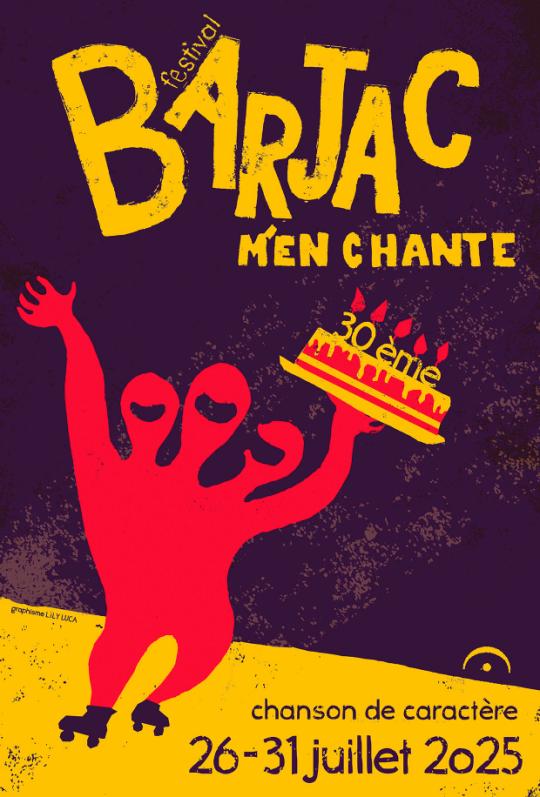Thibaut Defever, Le temps qu’il faut 2020 (© Maïwenn Le Guhennec)
15/10/2020 – Sortie du 1er album de Thibaut Defever (ex Presque Oui) sous son nom
Le temps qu’il faut
Avec
Le Well quartet (Widad Abdessemed 1er violon, Luce Goffi violon, Anne Berry alto, Chloé Girodon, violoncelle)
Thibaut Defever (composition, écriture, guitare, chant) Isabelle Haas (Co-écriture) Jean-Christophe Cheneval (arrangements) Antoine Sahler (direction artistique) Romain Clisson (mixage, prise de son) Maïwen Le Guhennec (conception graphique) Samuel Rozenbaum (conception graphique)
« Une île déserte en pleine mer, quand tout s’acharne autour de nous… Un bout de terre comme un radeau … c’est ça qu’il nous fallait ». Tout est dit dans cette chanson, Île, du nouvel album de Thibaut Defever, un album espéré depuis plus d’un an, des chansons dévoilées en concert avec Le Well Quartet, parfois mises en images. Et le voici cet album qu’il nous fallait dans ces temps qui nous malmènent, dans ces temps de couvre-feu, d’interdiction de se rassembler, de s’étreindre… Il nous les fallait, ces chansons de l’intime, du dedans, cette bulle où se réfugier « quand les éléments se déchaînent ».
Il en a fallu du temps – 20 ans pour tout dire – pour que Thibaut Defever trouve le chemin d’une création signée de son nom, comme une re-connaissance, une naissance à soi-même, tout en restant fidèle à son tandem en écriture avec Isabelle Haas. Le quartet à cordes qui se joint à sa guitare déjà si étonnante, lui offre, dit-il, un « orchestre en miniature » et force est de constater que c’est un écrin délicat qui souligne, escorte dans la sobriété, l’expression de sentiments profonds. On notera que l’album porte aussi le nom du quartet mettant ainsi en lumière la part musicale qui habille des « mots ciselés comme des émaux ». Les cordes, en effet, tantôt pincées, tantôt frottées avec l’archet, épousent les élans, les combats, les luttes, les douceurs et la tendresse aussi…
La couverture blanche de l’album est seulement illustrée d’une silhouette mince qui n’est pas sans rappeler celle des sculptures de Giacometti. Un homme seul dans l’immensité blanche où tout peut advenir, tout peut s’écrire pour peu qu’on lui en laisse le temps. Le graphisme est à l’unisson du texte, de la musique, tout en délicatesse, en nuances, comme des échappées de pinceau, des traits de plume, des esquisses, « Sans rien en lui qui pèse ou qui pose » dirait Verlaine.
L’album s’ouvre sur une invitation au voyage, un appel au départ, à la fugue quand la vie s’enlise… « Est-ce qu’on y croit encore ? Qu’est ce qu’on attend, dis ? » Retrouver « l’écume au galop, le train de nuit, le sac à dos »… Et c’est ainsi que vient le départ, la deuxième chanson, Je dérive, celle que Thibaut a si généreusement offerte quand il voulait saluer, dans des vidéos personnalisées, les acteurs de ce monde de la Chanson, au moment même où nos déplacements nous étaient comptés. … « Oublier d’où je viens, où je vais, j’en sais rien… » Nous faire partager ce voyage en train, cette fuite vers l’ailleurs, l’inconnu… On ne peut que conseiller à tous et à chacun de regarder la vidéo participative qui a pu voir le jour grâce au montage de fragments de voyage, un peu partout dans le monde, en train, en voiture, en bus, en tramway…
Bien sûr, on se saurait oublier que le voyage n’est pas toujours un agrément, que parfois c’est un exil, une fuite douloureuse, qu’un voyage est aussi soumis aux « vents contraires », au froid, à l’orage, à « la peur du pire et la hantise du naufrage »… Alors on n’a de cesse de tenir le cap, « les yeux rivés à l’horizon », de trouver son refuge, son port d’attache, son mouillage, le temps de reprendre souffle et vie, de « retrouver le goût de lire , d’écrire et de flâner » comme dans le titre éponyme, Le temps qu’il faut ou bien dans Des oiseaux, qu’auraient pu signer Georges Moustaki, Pierre Barouh, du temps de Samba Saravah… « Dehors dans la ville qui tremble, des oiseaux se rassemblent et espèrent »… Parfois aussi, pour ce voyage qui nous attend, ces lendemains dont on ne sait rien, puisque tout est éphémère, pour se sentir « l’âme légère » et libre, il faut s’arracher, même violemment, au passé comme dans le titre Brûle où l’incendie réduit en poussière la maison d’enfance…
Enfin, on ne saurait échapper au voyage essentiel, celui qui nous ravit et nous déchire, qui que nous soyons : le voyage de l’amour à deux… Cette navigation ne manque pas d’écueils, ainsi que le dit L’Artillerie lourde, chanson de guerre qui laisse parler la poudre, où les archets des instruments à corde mènent bataille, rompant avec la douceur de l’ensemble, au point de trouver ces mots « Une vraie boucherie ! », ou bien Dans la forêt, chanson où s’insinue la jalousie devant le mystère, l’énigme de l’être aimé … « Tu vas toujours plus loin dans la forêt »… Peut-on rivaliser avec « les frondaisons », « les grands arbres » ? Mais, soyons rassurés, l’album se referme sur la confiance, la certitude auxquelles se joint le chœur des voix féminines : « Nous vieillirons ensemble » (Nous). Bien sûr, comme le chantait Jacques Brel dans la chanson des vieux amants « nous eûmes des orages »… Bien sûr, « Faudrait pas les faux pas… Mais c’est comme ça… On ne se refait pas… L’essentiel est là : Toujours nous revenons à nous… »
On peut alors écouter à nouveau la chanson Île, et croire en ce « bout de terre comme un radeau dans les remous. »
« La mer est d’huile, le ciel est bleu, un poil de vent… C’est ça qu’il nous fallait »