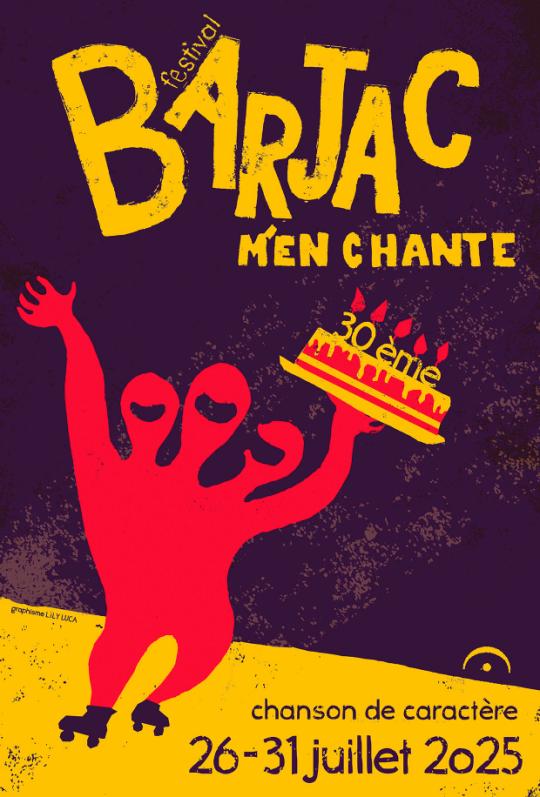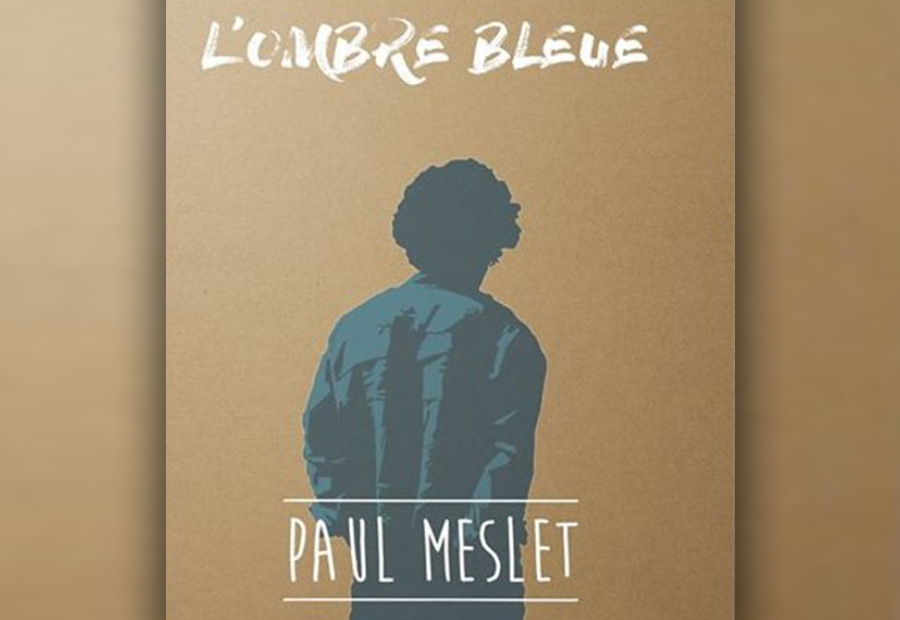
Paul Meslet, L’ombre Bleue (© Emmanuel Meslet – Olivier Coiffard)
26 décembre 2016 – album L’Ombre Bleue
avec Paul Meslet (paroles, sauf Jean-Pierre Routhiau pour 6 & 13, musiques, guitare), Tony Baker (piano), Francis Jauvain (accordéon, accordina), Denis Tarsiguel (guitare, batterie), Olivier Moret (contrebasse) et l’amicale collaboration de Michel Boutet.
« Tout le monde sait que l’automne
C’est la saison de la braconne
Que ce qui n’est pas cueilli là
L’hiver l’emportera » (Les Prés carrés)
L’homme qui écrit ces octosyllabes, qui les chante au rythme sautillant et malin du piano, secondé par la contrebasse, par un accordéon qui donnerait envie de se mettre à danser, délivre là un joli credo.
Allons‑y gaiement ! Compagnons d’une vie bien mûre, goûtons la vie avant qu’il ne soit trop tard ! Hymne aux provendes de la vie, à la liberté épicurienne qui fait fi des entraves de toutes sortes, « Les prés carrés les fermetures / Les boulons les liens les clôtures »… Optons enfin pour le Déraisonnable qui « Nous allume nous enflamme /La tête le cœur et l’âme /Quand il pleut » auquel invite la dernière chanson de l’album.
Si vous avez déjà croisé l’homme en question, Paul Meslet, vous savez que la neige qui lui est tombée sur la tête, ajoute à la séduction de ses yeux d’un bleu profond et de son sourire chaleureux. On comprend mieux que le bleu souvent s’invite dans sa poésie qui « repeint le ciel en bleu ». Obstinément.
Sa plume s’est trempée longuement, goulument à d’autres plumes. Sa voix s’est frottée à d’autres voix qui se sont tues. On pense bien entendu à un certain Jean d’Antraigues bien sûr, qu’il honore si souvent, mais aussi à la cohorte d’autres auteurs qui ont semé leurs mots en guirlandes. Ils ont illuminé sa mémoire, comme la nôtre, et jaillissent, se glissent, font irruption au bout des doigts – sans même que l’on s’en rende compte. Ce sont poèmes de l’Ombre bleue, celle qui jamais ne nous laisse « dans les déserts les catacombes /Dans les couloirs et les tunnels », qui nous escorte dans notre quête sans fin de « mer, de sel, d’air et de ciel ». J’en veux pour preuve ces premiers mots de cette chanson éponyme : « Heureux celui qui croit comprendre »… Comment ne pas entendre en écho « Heureux celui qui comme Ulysse… » d’un certain Joachim Du Bellay, angevin, tout comme notre chanteur ? Comment de pas entendre Verlaine dans la délicate ballade, Je peins des ciels, signée Jean –Pierre Routhiau : « Il pleut des cordes /Et des violons /En faux sanglots /Si lents si longs… » Comment ne pas réveiller en nous le souvenir de François Villon en entendant les premiers mots de Frères humains qui, dans une semblable ferveur en appelle à chanter la « beauté du désordre, la vie, la paix » ? Et ces mots « Ce serait si peu que j’en tremble /Que de parler un peu d’amour »… Aragon ? Ferrat ? Les deux sans doute.
Mais les chansons de Paul Meslet se nourrissent aussi d’un espace bien tangible celui –là, d’une matière vivante, faite d’eau, de sel et de glaise. Cette terre de France où il vit, entre Nantes et Anger, dont la douceur s’est faite légende. Ces bords de Loire aimés des rois, ces marais salants, ne sont pas pour rien dans cette écriture, cette peinture. Qu’il chante l’amour d’une femme mi muse – mi sirène, fuyante comme l’eau, qui laisse « Un drôle de goût sur la langue » (Elle est de sel). Qu’il file la métaphore du funambule (Marcher sur un fil) pour évoquer l’équilibre fragile de nos vies, notre aspiration à l’envol, « Sans avoir les ailes /Des grands oiseaux blancs ». Qu’il choisisse plutôt l’image typiquement angevine des « boules de fort » (Mamans girondes) « Et ça titube et ça nous saoule /On s’arrêt’ra quand on s’ra mort… ». Qu’il signe enfin une chanson d’une bouleversante beauté, adressée à sa grand-mère, Aurelina, en lutte contre la maladie, la mort. Il y convoque tout ce que la nature peut offrir au jardin de plus doux et de plus simple. Au moment de se faire la belle, « As-tu entendu la grive /La fauvette le coucou… ? » Piano et contrebasse à l’archet soulignent cet appel vibrant à la vie. Car s’il n’ignore ni la mort, ni le feu, ni la cendre, Paul Meslet choisit de donner rendez-vous à l’été, à la pluie qui va tout laver… Comme dans la fin de ce texte de Jean-Pierre Routhiau – étrange coïncidence avec les derniers jours d’Alep la rebelle – « Un jour qui s’enfonçait dans l’ombre /Dans la froideur et les décombres /J’ai vu mon cœur de palissandre /Se fendre ». Voix et contrebasse seulement.
Finalement dans cet album dense et profond, on élira l’émotion que fit naître la voix. Non pas la voix qui chante, mais celle qui dit, accompagnée de notes délicatement impressionnistes. La poésie s’y est faite majeure. Alexandrins en rimes croisées… « Nous avons dans les mains les mêmes gouges fines /Les mêmes bistouris et les mêmes marteaux »… Qu’allons- nous faire de nos vies ? La voix aussi de celui qui signe et chante jusqu’à la véhémence, le cri poussé pour la mère par son minot, longtemps après ce « 14 octobre 1916, il pleut des obus sur Verdun »… Mais c’est d’une naissance qu’il s‘agit, celle d’ « une mésange blessée ». Car il est des combats « sans bruit sans mitraille » qui exige que l’on reste debout, même avec une Gueule cassée.
Beauté et force inouïes de cette déclaration d’amour.
Après elle, le prix du silence.